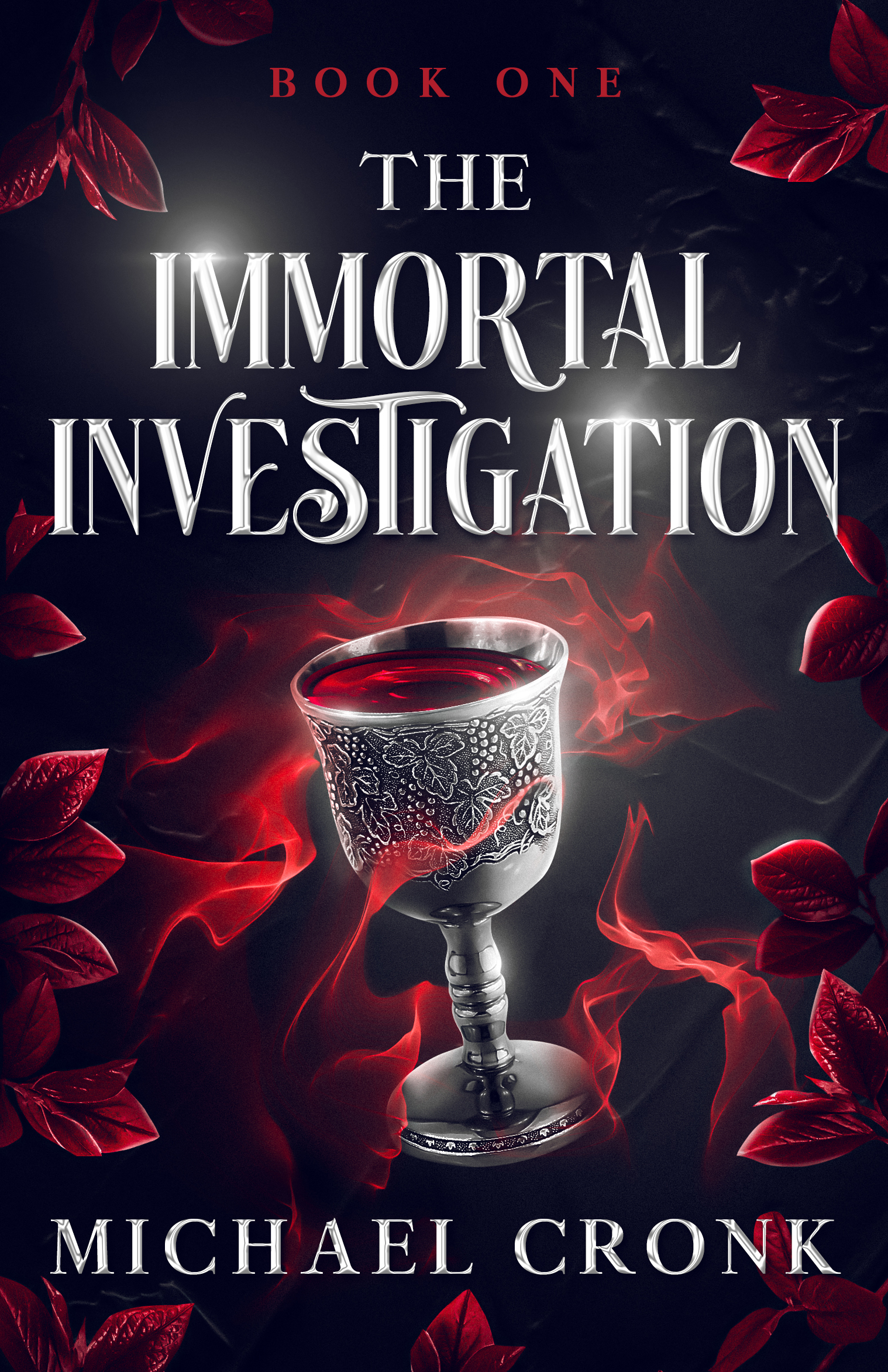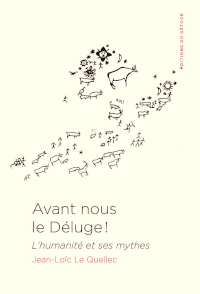Une histoire des civilisations est un ouvrage co-dirigé par les archéologues Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia, et Alain Schnapp, publié en octobre 2018 chez La Découverte. Il s’agit d’une synthèse de l’histoire des civilisations humaines, prenant en compte les recherches archéologiques les plus récentes sur chacun des sujets abordés.
Depuis les années 1980, une révolution silencieuse a bouleversé nos connaissances sur l’histoire de l’humanité : celle suscitée par les extraordinaires progrès techniques et méthodologiques de l’archéologie, particulièrement grâce au développement de l’archéologie préventive. Nombre des représentations d’hier ont été nuancées, des pans entiers de cette histoire, jusque-là ignorés, ont été mis au jour. Mais si cette révolution a donné lieu à un foisonnement de publications scientifiques, il manquait une vision globale, accessible aux non-spécialistes. C’est ce défi qu’ont voulu relever ici trois des plus éminents archéologues français.
Réunissant les contributions de soixante et onze spécialistes mondiaux, associées à une riche iconographie et à une cartographie originale, cet ouvrage propose une histoire renouvelée des civilisations. Il couvre l’ensemble des périodes et des continents, en mettant l’accent sur les avancées les plus significatives : la localisation du berceau de l’hominisation, les origines et l’extension des civilisations sédentaires, les stratégies économiques et politiques qui ont mené à la fondation des grands empires et les conditions de leurs dislocations, les modalités de la mondialisation des époques moderne et contemporaine, sans oublier les migrations qui se sont succédé de la préhistoire jusqu’à nos jours.
Grâce à cette vision globale de l’aventure humaine, on découvrira comment l’archéologie apporte sa contribution à la connaissance des sociétés sans écriture comme à celle des civilisations de l’écrit. Et comment elle rend possible un nouveau dialogue entre sources textuelles et sources matérielles, qui bouleverse plusieurs domaines de l’histoire ancienne, médiévale et moderne.
C’est un gros pavé, qui regroupe les contributions de soixante-et-onze spécialistes dans leur domaine respectif. C’est aussi un beau livre, avec des illustrations et une cartographie inédite de grande qualité.
L’ouvrage est découpé en 5 grandes parties, les quatre premières suivent un fil chronologique, la dernière étant consacrée à des sujets transversaux et méthodologiques :
- L’ hominisation et les sociétés de chasseurs-cueilleurs
- Les premières sociétés agricoles
- Origine et extension des États centralisés
- Des empires à la mondialisation
- De nouveaux champs d’étude pour l’archéologie
Chacune des parties débute par une introduction d’une vingtaine à une trentaine de pages qui présente les étapes majeures de la chronologie, les grandes évolutions, et les grands enjeux. Suivent des chapitres thématiques de cinq à dix pages qui abordent une aire géographique à une période chronologique donnée, ou une thématique transversale.
Comme souvent dans ce genre d’ouvrage, tous les thèmes et donc tous les chapitres ne passionneront pas tous les lecteurs. L’organisation du livre permet de suivre le fil des sujets abordés tout en passant rapidement sur les chapitres qui attirent le plus l’attention et l’intérêt du lecteur. C’est en tout cas ce que j’ai fait, alternant lecture attentive de certains chapitres et plus superficielle de l’autre, au gré de mes inspirations.
Quoi qu’il en soit, j’ai beaucoup aimé cette lecture. Le livre peut sembler impressionnant mais il est accessible et passionnant. J’ai particulièrement aimé que les auteurs mettent en avant les recherches les plus récentes mais aussi les débats sur les sujets qu’ils abordent. J’ai également adoré suivre cette histoire de l’humanité au long cours, à travers les traces qu’elle a laissées.
J’ai envie de conclure avec quelques citations glanées au fil de ma lecture.
Dès l’introduction, j’ai noté cette citation que j’aime beaucoup sur l’étude du passé :
Étudier le passé, c'est perpétuer la longue chaîne de ceux qui ont vécu avant nous pour jouer notre rôle dans la continuité de l'évolution des groupes humains. Les hommes comme les sociétés ont besoin de la mémoire, non seulement pour satisfaire leur curiosité, mais pour s'assurer de leur place dans le monde, pour se reconnaître dans la suite infinie des générations.
Sur les effondrements successifs des sociétés du néolitihique :
Cette marche vers des sociétés de plus en plus complexes et finalement étatiques et urbaines n'a pas été continue, du moins pas partout dans le monde. Dès le VII millénaire, les grandes agglomérations du Proche-Orient avaient disparu au profit de villages beaucoup plus modestes. Celles de l'Europe orientale, avec les cultures de Cucuteni-Tripolje de Roumanie et d'Ukraine, qui rassemblaient plusieurs milliers d'habitants, s'effondrent à la fin du Ve millénaire. En Chine, au III millénaire, la brillante culture de Hongshan, avec ses tombes somptueuses et ses sanctuaires, s'efface au profit de petites communautés agricoles. Plus tard, en Europe, ces débuts d'urbanisation que sont les palais crétois et les citadelles mycéniennes s'effondrent vers 1200 avant notre ère, comme une partie des civilisations de la Méditerranée orientale, pour faire place à des « âges sombres», à l'instar des cités de l'Indus au III millénaire ou, à la fin du vie siècle avant notre ère, les « résidences princières » celtiques d'Europe occidentale, ou encore le célèbre effondrement des Mayas à la fin du Ier millénaire de notre ère, ainsi que celui des cités mississippiennes à peine plus tard.
Au-delà du constat banal du caractère éphémère des sociétés humaines, ces effondrements répétés posent question. Les causes paraissent à chaque fois multiples, impliquent la plupart du temps des raisons environnementales, dues à des dégradations climatiques momentanées, mais qui peuvent aussi avoir été accélérées par l'action humaine. En fragilisant les pouvoirs en place, ces phénomènes peuvent favoriser, par un effet « chaotique » ou « en domino », des réactions sociales contre un pouvoir devenu moins légitime, précipitant d'autant sa chute. L'environnement semble aussi jouer un rôle à un autre titre. Là où l'espace est limité, comme en Égypte ou en Mésopotamie, il sera beaucoup plus difficile aux populations de se disperser. Là où il l'est moins, ainsi en Europe ou dans la vallée de l'Indus, un retour à des formes de vie villageoises et disséminées sera beaucoup plus aisé.
Sur le récit de « progrès civilisationnel » pour justifier la colonisation :
Dans ses grandes lignes, la notion de « progrès » était associée à une hiérarchie culturelle allant du simple au complexe : des économies fondées sur la subsistance jusqu'aux sociétés plus élaborées reposant sur l'agriculture.
Même si les termes précis de ce récit ont évolué au cours des quatre siècles qui ont suivi, ce schéma global a abouti au XIXe siècle, avec les écrits du préhistorien et naturaliste britannique Sir John Lubbock et de l'ethnologue américain Lewis Henry Morgan, à une histoire évolutive des sociétés humaines, de l'état de «sauvage» à celui de «barbare», puis de «civilisé»; on était alors persuadé d'avoir établi des liens clairs entre la technologie, les stratégies de subsistance et les formations sociales complexes. En termes plus brutaux (qui étaient d'ailleurs ceux de l'époque), le schéma était le suivant : les populations partageant une culture matérielle paléolithique vivaient en bandes du produit de la chasse et de la cueillette, ceux qui partageaient une culture matérielle néolithique pratiquaient l'agriculture et vivaient dans des villages en obéissant à des structures sociales plus complexes, et ainsi de suite, jusqu'au jour où les êtres humains parvenaient à la civilisation, à la science et à l'État. Cette séduisante trajectoire ascendante de l'histoire humaine (dont le point culminant était les puissances coloniales européennes) constituait un «fait» établi à l'échelle planétaire et il appartenait à l'archéologie d'en faire mondialement la démonstration. Notons que, durant tout le XIXe siècle et la presque totalité du XXe, les mouvements majeurs survenus le long de cette trajectoire (considérés comme des indices de «progrès») résultaient pour les chercheurs de «révolutions» – comme la «révolution» agricole, la «révolution» urbaine, etc. Un grand nombre de théoriciens les considéraient comme des événements exceptionnels, fondateurs de principes centraux, à partir desquels l'agriculture et l'urbanisme s'étaient «répandus» dans les sociétés périphériques par le biais de processus migratoires et commerciaux.
Souvenons-nous également que la plupart des nations de l'Océanie d'aujourd'hui sont des créations postcoloniales, anciennes «possessions» de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Hollande, de l'Allemagne et des Etats-Unis. La colonisation – un processus rarement pacifique – était étroitement liée à la théorie du «progrès», laquelle justifiait de facto la dépossession des groupes indigènes, Ce fut surtout le cas en Australie, où les sociétés indigènes étaient considérées comme étant parmi «les plus simples» du monde: des chasseurs-cueilleurs proches du véritable «état de nature». En Océanie, l'archéologie et l'anthropologie jouent un rôle vital dans les débats nationaux actuels à propos de l'histoire indigène et de la célébration d'une survie culturelle en dépit des séquelles du colonialisme. Les découvertes concernant la diversité de l'Océanie préeuropéenne (en particulier en Australie) participent activement à la refonte de l'identité indigène.
Sur l’intensification des conflits au Néolithique :
L'intensification des conflits semble corrélée à l'augmentation de la démographie locale en Europe à l'arrivée d'agropasteurs venus d'Anatolie et au développement de l'économie de production qui, très tôt, engendra un changement radical des structures sociales. Les activités agropastorales nécessitant de plus en plus de terres cultivables, une concurrence croissante pour leur obtention transforma les conflits entre groupes, relativement peu meurtriers, en de véritables massacres, comme l'atteste la découverte de charniers. En outre, contrairement à l'exploitation des ressources sauvages, la production d'aliments permit l'obtention d'un surplus de nourriture. Très vite, les denrées stockées suscitèrent des convoitises, firent naître le concept de «propriété» et provoquèrent des luttes internes. Butins potentiels, elles entraînèrent des conflits entre communautés. En Europe occidentale, avec la seconde vague de néolithisation au cours du Vie millénaire, survint une nouvelle organisation sociale marquée par une plus grande hiérarchisation avec l'apparition d'une élite (émergence de la figure du chef) et de castes, dont celle des guerriers, et de son corollaire, les esclaves. Les travaux des champs nécessitant une main-d'œuvre plus abondante que celle que pouvaient fournir les habitants d'un village, il fallut sans doute recourir à de nouvelles forces de travail. Les prisonniers de guerre furent dès lors transformés en esclaves qui pouvaient faire souche et ainsi accroître la communauté. L'apparition d'une élite avec ses intérêts et ses rivalités propres entraîna le développement de conflits internes pour l'accession au pouvoir et aux biens et, s'appuyant sur la caste des guerriers, à des conflits intercommunautaires.
Sur l’avènement, pas forcément inéluctable, de l’État :
Dans la trajectoire de l'évolution des sociétés humaines, l'État n'est donc pas un aboutissement inéluctable, un point d'équilibre idéal, mais le dépassement d'un schéma «naturel», l'artificialisation d'un mode d'organisation du vivant. Le groupe est gouverné par une élite qui se revendique née des dieux ou de la Terre. Il constitue donc le « peuple premier » qui, par principe, domine l'ensemble de la communauté et s'arroge le droit de produire de nouvelles règles et de les substituer aux lois de la nature. Ce scénario, cette trajectoire, ce cadre est bien résumé par l'anthropologue Maurice Godelier pour qui «les sociétés humaines ne vivent pas en société mais elles produisent de la société pour vivre ». Ces productions sociales – ces franchissements de seuils – s'expriment dans plusieurs domaines économiques et culturels dont le résultat le plus maîtrisé semble l'organisation de la société.
L'État, que nous venons de présenter comme une organisation sociale suprafamiliale très codifiée, s'octroie la maîtrise directe – au-delà de la gestion domestique – des biens matériels des espaces et des hommes : c'est donc tout un « surplus» matériel, spatial et humain qui va être pris en charge et valorisé par une classe dominante. C'est bien ce levier particulier, cette «production sociale» supplémentaire, qui va marquer l'avènement de l'État et permettre l'affirmation de deux paramètres caractéristiques essentiels : les capacités coercitives et la légitimité politique.
Sur la naissance de l’État et d’une classe dominante :
La sédentarisation et l'essor démographique, en lien avec des modifications des pratiques agraires, apparaissent donc comme les ferments de la mise en place des États naissants, ayant pour marqueur de leur développement l'espace urbain. Dans ce cadre, l'organisation étatique va se substituer au phénomène « naturel» découlant de l'augmentation du taux de croissance démographique et qui entraînait l'« essaimage». En effet, le phénomène urbain conduit rapidement, selon l'historien Arnold I. Toynbee, à une situation de «non-autosubsistance», qui se traduit chez les habitants de l'agglomération par une nouvelle façon de se nourrir – et, plus largement, de consommer. Celle-ci ne repose plus que sur les activités agropastorales locales mais passe par des activités commerciales d'échanges et, par la suite, induit l'émergence d'un artisanat. Ce passage d'une « économie rurale» vers une « économie urbaine » entraîne soit une intensification de la production agricole dans les terroirs environnants, soit un développement des échanges de courte ou de longue distance.
Dans les deux cas, la maîtrise de la consommation se fait par la gestion du stockage – en particulier dans des greniers. Quand la production régionale est privilégiée, afin de garantir un approvisionnement satisfaisant, les efforts se concentrent sur la maîtrise et la valorisation des sols, avec le développement d'une ceinture vivrière et l'augmentation ou la régulation des rendements par une meilleure gestion des terres (irrigation, techniques agraires, apport de main-d'œuvre complémentaire...). Quand le choix se porte sur les apports vivriers extérieurs, cela implique d'établir des contacts réguliers et sûrs, de fabriquer des biens servant de contreparties (des produits finis ou semi-finis) et de maîtriser, voire de sécuriser, les voies de circulation. Dans les deux cas, la gestion des stocks est indispensable (gardiennage, comptabilité...) et peut être considérée comme un autre marqueur d'une société étatique.
Les fonctions politiques et religieuses sont exercées par une classe de dirigeants dont le niveau de consommation va souvent être plus élevé que celui des autres personnes de la communauté. Ils vont organiser la planification des activités par la maîtrise d'outils adaptés – la comptabilité et l'écriture –, puis assurer sa fluidité par l'usage, plus tardif, de la monnaie. Ils sont garants de l'équilibre du système par leur activité de redistribution des biens, mais aussi par le maintien de la sécurité qui va être prise en charge par un corpo spécial répondant à des règles définies et généralement acceptées. On assiste au même moment à un glissement des activités religieuses qui, dans les sociétés dites primitives, dictaient le déroulement « naturel » des choses alors que les sociétés étatiques vont les garantir en confortant le pouvoir de la classe dirigeante.
Dans ces sociétés urbaines préétatiques et étatiques, artisans, commerçants et guerriers ne participent plus de façon notable aux tâches agricoles. Il est communément admis que la spécialisation du travail est, dans toutes les sociétés, l'étape qui suit un développement agricole significatif. L'augmentation de la production agricole libère une partie de la main-d'œuvre indispensable à l'essor urbain, que ce soit pour des productions para-agricoles, l'artisanat du métal et de la céramique en particulier par la fabrication d'outils et de contenants, ou pour des activités de service comme l'organisation du commerce. Ce dernier fait partie intégrante de la cité et, pour les plus importantes, il impliquait la présence d'une classe de marchands spécialisés dans la collecte et la redistribution des vivres, comportant un corps de professionnels adonnés au stockage, au transport et à la comptabilité. Ce système implique donc de nouvelles formes de mobilisation du travail et d'accumulation du capital, entraînant le recours à un travail servile ou salarié et la collecte de tributs et de taxes.
La gestion de ces ressources, à un certain niveau de production, ne peut être maîtrisée et contrôlée que par la mise en œuvre d'une comptabilité suivie, dont l'écriture est l'outil dédié; son existence est avérée en Mésopotamie à partir du milieu du IVe millénaire. Combinée à une standardisation des poids et des mesures, la mise au point de systèmes de comptabilité est une innovation majeure, qui va fournir à l'État les fondements d'une organisation efficace et accentuer un mouvement de complexification sociale, impulsée notamment par la croissance du commerce extérieur. C'est seulement, le plus souvent, dans un second temps que l'apparition de la monnaie permet de fluidifier les échanges. L'administration nouvellement constituée apporte les cadres qui permettent la formation de centres entrepreneuriaux: l'accumulation du capital couplée à la recherche de profits s'est d'abord développée avec l'appareil d'Etat et les institutions des palais ou des temples.
Phénomène déterminant dans la trajectoire des communautes humaines, l'apparition des sociétés étatiques peut, cependant, être considérée comme une anomalie. En effet, des contrôles« naturels» des formes du pouvoir sont connus et, dans des environnements controleaux ressources riches et variées, l'accroissement de la production peut accompagner stendustraines sociales 'évolution des communautés Poursuivant l'hypothèse de Clastres, Jean-Paul Demoule a rappelé en 2017 que la « norme de l'évolution des sociétés humaines ne serait pas d'aller vers une hiérarchisation de plus en plus forte, mais qu'au contraire des mécanismes de contrôle caractérisaient normalement les sociétés simples, pour empêcher toute montée d'un pouvoir coercitif, soit par la remise en jeu de leur pouvoir par les chefs (guerriers prestigieux), soit par le mécanisme de solidarité, ou encore par la redistribution de biens alimentaires par les big men des sociétés primitives pour conserver leur prestige...
En fait, si on admet que l'État est une « dérégulation sociale » résultant de plusieurs phénomènes imbriqués, l'essor démographique semble alors être le facteur commun à chacun des exemples exposés. Ainsi, l'État apparaît comme le mode d'organisation politique adapté lorsque, dans un territoire donné, la croissance d'une population humaine dicte la dynamique des modes de production au lieu de s'y soumettre. Cet accroissement démographique a puêtre initié par des améliorations climatiques, la mise au point d'innovations techniques (irrigation, arboriculture...) ou la maîtrise de nouvelles ressources (métal...). Dans ce cadre, la gestion des stocks d'une production supérieure aux besoins de subsistance du groupe va pouvoir être réalisée par un personnel spécialisé. Grâce au prélèvement d'une part des récoltes sous forme de tribut ou d'impôt, une régulation de la consommation de la communauté est assurée. Ces prélèvements permettent, également, de subvenir aux besoins d'un personnel armé assurant la sécurité interne et externe du groupe. Ecriture et usage de la monnaie sont les deux outils assurant une fluidité de la gestion du système.
La coordination de l'activité politique est assurée par une élite dont l'autorité est renforcée par une dimension religieuse et la captation de biens de prestige. En fait, l'Etat apparait Le plus souvent lorsque le mode d'économie domestique ne permet plus «naturellement» de satisfaire les besoins d'un groupe en plein essor. Se développe alors un mode économique supradomestique qui vient réguler ces besoins. C'est au nom d'un ordre divin – donc «naturel» – que l'autorité nécessaire à sa mise en œuvre est exercée.
Le passage d'une société à pouvoir diffus vers une société à pouvoir centralisé a pu être freiné par les mécanismes de contrôle déjà évoqués mais également par les caractéristiques du biotope régional: diversité, instabilité climatique, cloisonnement ou extension des terroirs (en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Nord), isolement des groupes (en Océanie) ou – inversement – dissolution dans un réseau dynamique (en Gaule) ou absence de sédentarisation (populations steppiques ou caravanières en Asie centrale)... Ces causes naturelles ont souvent été affermies par des visions du monde et des représentations collectives variables d'une culture à une autre.
Sur l’expansion grecque :
Depuis des siècles, l'historiographie désigne le mouvement dont nous parlons par le nom de «colonisation grecque». Mais il faut souligner d'emblée que les déplacements des Grecs vers l'Asie Mineure ne furent en aucune manière les projections de poleis structurées, comme nous les rencontrons à partir du Ville siècle.
Aussi préférons-nous le terme de «migration», sous réserve des correctifs apportés plus haut quant à la durée d'un mouvement qui, nous l'avons dit, s'étendit dans le temps et ne fut en rien simultané. L'expression «colonisation grecque» est d'ailleurs trompeuse et inadéquate puisque le mot «colonisation», du latin colere avec le substantif colonia qui en dérive, n'était pas employé par les Grecs eux-mêmes pour décrire leur départ du pays natal dans le dessein de fonder une cité nouvelle. Le concept de colonia, propre au monde romain, implique en fait (et aujourd'hui encore dans les langues modernes) la domination du colon et de celui qui le délègue, dans l'intention première d'exploiter les ressources d'un territoire. Le Grec parle de son côté d'apoikia, et nomme apoikismos le mouvement afférent, lequel est sans rapport avec l'idée d'exploitation. Apoikia signifie «éloignement du foyer», séparation du milieu d'origine; c'est de cela dont il est question, et de rien d'autre. Ainsi rien ne nous autorise à supposer qu'une entreprise d'exploitation impérialiste ait motivé le mouvement grec, bien que chacun persiste à le qualifier de «colonial» par tradition, tout en convenant de l'anachronisme et de l'impropriété du terme.
Sur la conquête de l’Amérique et la colonisation du monde :
Cette conquête unifiait pour la première fois l'ensemble du monde habité, du moins du point de vue des Européens. Elle reposait non seulement sur la maîtrise de technologies nouvelles mais aussi, et surtout, sur une volonté de savoir et de domination qui voyait dans l'exploration géographique un des moyens de la colonisation du monde, et que renforçait l'assurance d'un monothéisme arrogant et intolérant. Les Arabes et les Chinois, et bien d'autres avant eux, avaient disposé de ressources équivalentes ou même supérieures à celles des Européens, mais aucun de leurs empereurs n'avait si fortement associé le savoir à l'esprit de conquête et à la « soif de l'or ».
La conquête des Amériques est le premier acte d'une colonisation universelle qui allait donner aux Européens du xve au XIXe siècle les moyens d'un contrôle économique sans précédent des ressources du monde habité – mais qui semble maintenant s'achever.
Une stratégie, celle du capitalisme, de l'expansion croissante de la production de ressources et de biens, devenait ainsi l'outil d'un impérialisme de type nouveau qui ne reposait pas seulement sur les convictions religieuses et les ressources militaires, mais aussi sur l'emploi de moyens de domination étroitement liés aux savoirs des ingénieurs et des banquiers.
La colonisation des Amériques consacre l'alliance entre le capital et la science pour jeter les bases d'un monde unifié. Les entreprises privées coloniales, par exemple les compagnies hollandaises des Indes orientales et occidentales, deviennent des sortes d'organismes parapublics dotés de pouvoir régaliens et de la faculté de lever des armées.
Cette unification du monde est d'abord celle des marchés qui s'enrichissent des profits énormes de l'exploitation des mines en Amérique, du commerce maritime des épices et de la traite. Autant les esclaves étaient rares dans l'Occident chrétien, autant au XVIe siècle ils deviennent la pierre angulaire du commerce triangulaire entre les Amériques, l'Afrique et l'Europe. Le XVIIIe siècle voit l'émergence des empires coloniaux ainsi que l'affirmation de l'échange inégal et imposé entre l'Europe et le reste du monde.
On ne saurait en effet oublier que la colonisation des Amériques s'est faite au prix de la déportation et de l'esclavage pendant trois siècles de plus de 10 millions d'êtres humains – ce qui est désormais reconnu comme un crime contre l'humanité. Que l'esclavage ait existé dès les premières grandes civilisations urbaines et que l'Afrique subsaharienne ait été déjà au Moyen Âge ponctionnée par la traite dite « orientale» en direction du monde musulman n'en exonèrent pas pour autant les puissances occidentales. Ce commerce triangulaire, qui fit la fortune de Bordeaux, de Nantes ou de La Rochelle, comme de Londres, de Liverpool et de Bristol, se faisait aux dépens des populations de l'Afrique occidentale, et jusqu'en Angola, déstructurant durablement ces régions.
Sur la révolution industrielle et ses conséquences :
Au XVIIIe siècle se font jour les prémices d'une société industrielle avec les premières machines à vapeur capables d'extraire l'eau des mines, la première coulée de fonte au coke, la mise au point des machines à filer et les expériences d'éclairage au gaz. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne augmente considérablement sa production manufacturée et devient un pays préindustriel qui jette les bases de la nouvelle économie mondiale. La déclaration d'Indépendance des colonies britanniques en 1776 ne change pas immédiatement la donne, mais elle ouvre la voie à la colonisation de l'ouest du continent nord-américain et à la création d'une puissance économique d'un nouveau genre, les États-Unis d'Amérique, colonie qui devient elle-même colonisatrice.
Désormais la révolution industrielle est en marche; elle accompagne la constitution et l'expansion d'un colonialisme appuyé sur les ressources économiques et militaires des grands États européens.
Zéro Janvier – @zerojanvier@diaspodon.fr
Discuss...